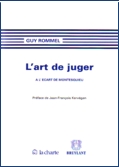Guy ROMMEL
Bruylant, Bruxelles, 2008
Toute pratique du droit, qu’elle s’effectue de plein droit – cas le plus fréquent – ou par le biais d’un conflit, s’oriente implicitement ou explicitement – que déciderait le juge ? – en fonction de l’acte de juger, qui en constitue le dernier mot et donc le noyau dur. Si l’acte de juger ressortit ainsi habituellement au genre “pratique du droit” et à l’espèce “application de la norme au fait”, celle-ci n’opère pas là de plano, mais moyennant l’affrontement falsificatoire de prétentions contraires, qu’il appartient au juge de départager. Quatre moments de l’art de juger sont considérés, dans la diachronie et dans la synchronie : appliquer, pratiquer, conjuguer, assagir.
“Appliquer” réfère, chez le juge, à une action extérieure, semblable à l’expérience scientifique : toutes deux poursuivent, l’une dans la forme d’une procédure et l’autre dans celle d·un protocole, ce qu’elles qualifient comme objectivité. Celle-ci n’est objective qu’en vertu de leurs propres critères. “Pratiquer” pose un regard critique sur la dogmatique de l’application et en révèle les implications positivistes pour l’acte de juger. “Conjuguer” pénètre dans l’épaisseur du geste et montre à la fois ce que le juge accomplit en vérité et comment le juge s’accomplit. Conjuguer comporte en effet indissociablement une activité transitive et une activité réflexive : conjuguer conjugue les quinze verbes constitutifs de l’art de juger et, conjuguant, le juge se conjugue lui-même. Ce faisant, le juge s’assagit, mais cette sagesse ne se donne à lire qu’au creux du conjuguer comme la vie de son mouvement. Telle est la tâche, le chantier existentiel, que met en oeuvre – qui met en oeuvre aussi – sans désemparer le juge.
- En savoir plus : Site de l’éditeur